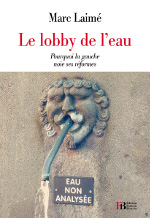L’association d’usagers toulousaine a analysé les effets pervers d’une annonce démagogique, qui vise d’abord à préserver les intérêts des concessionnaires de la métropole, Veolia et Suez.
« Toulouse-Métropole, par délibération du 4 avril 2024, est la première intercommunalité importante à avoir mis en place une tarification saisonnière (1). Pour rappel, cette tarification se traduit par une augmentation du tarif (eau et assainissement) de 42% sur les cinq mois de juin à octobre, et une réduction de 30% sur les sept autres mois. La mesure prend effet à compter du 1° juin 2024.
Notre association, EAU SECOURS 31 (ES 31), s’est rapidement prononcée contre cette mesure, par distribution de tracts sur les marchés et manifestations, communiqué de presse, lettre ouverte à Jean-Luc Moudenc, président du Conseil de Métropole et maire de Toulouse, et enfin par une distribution de tract le 4 avril aux élu.e.s de la Métropole.
Il est intéressant de revenir sur les débats de cette journée qui ne font que confirmer et donner un nouvel éclairage sur les enjeux réels de cette mesure.
La démocratie bafouée
Soulignons d’abord que dès les interventions liminaires des divers groupes d’élu.e.s en début de séance, l’accent a été mis, notamment dans l’intervention de K. Traval-Michelet (PS) sur l’absence totale de concertation : annonce dans la presse avant même tout travail de la commission eau de la métropole, seule hypothèse envisagée, pas d’étude d’autres alternatives. Cela est si vrai que Pierre Trautmann (2) avait rajouté au diaporama présenté le 14 mars à la C.C.S.P.L. (3), une diapo supplémentaire listant toutes les réunions qui avaient soi-disant préparé les débats du 4 avril. ES 31 et d’autres associations avaient déjà protesté sur cette absence de démocratie lors de la tenue de la C.C.S.P.L.
Ce n’est pas seulement en été qu’il faut économiser l’eau
Très peu d’interventions (à part celle de J. El Arch) ont situé ce débat dans une perspective plus globale, celle du cycle de l’eau. Nous disions dans notre tract du 4 avril :
« Ce n’est pas seulement l’été qu’il faut économiser l’eau. C’est toute l’année que les nappes phréatiques se rechargent. Permettre à ce cycle naturel de retrouver un cours normal passe par la baisse de la consommation d’eau pour l’ensemble des activités humaines tout au long de l’année. Faire payer l’eau moins cher l’hiver, donne le message tout à fait contraire. »
La compréhension de cette question par P. Trautmann se limite à cette absurdité dans la diapo 4 : « Toute goutte d’eau non nécessaire à la Garonne qui se retrouve dans l’Océan est une goutte d’eau perdue ». Absurde car la Garonne a bien besoin de beaucoup de gouttes d’eau pour le maintien de sa biodiversité, pour diluer toutes les pollutions résiduelles de toutes les stations d’épuration qu’elle croise sur sa route, pour refroidir la centrale de Golfech, pour garder un équilibre (de salinité) dans son estuaire, sans parler de l’Océan lui même qui en a un grand besoin.
P. Trautmann a répondu la 4 avril à nos arguments en ne prenant en compte que le soutien d’étiage, affirmant que ces gouttes perdues pouvaient être stockées quand la Garonne a un débit de 250 m3/s . Dans de nouveaux barrages ? Des méga-bassines ? Pour « stocker l’eau » la priorité absolue est aujourd’hui de redonner à la nature sa capacité à la capter dans les sols. Priorité donc à la désimperméabilisation des sols tant en milieu urbain qu’agricole, à la restauration des zones humides, au ralentissement du cours du fleuve et de ses affluents (4).
« Ce n’est pas chez nous que ça se joue »
L’argumentation de P. Trautmann se fonde sur une réalité : alors que la ressource en eau dans les différentes usines de potabilisation provient en France pour 2/3 des eaux souterraines, et 1/3 des eaux de surface, à Toulouse 99% des eaux viennent de la Garonne. Et comme les études prévoient une réduction des débits de la Garonne de 20% à 40% à l’horizon 2050, dans la zone la plus concernée par cette réduction de débits, il convient donc de faire des efforts particuliers pour répondre à l’objectif de réduction de la consommation de 10% d’ici 2030 qui figure dans le plan Macron de 53 mesures présenté en mars 2023. Et P. Trautmann de rappeler qu’en 2023, 61,1 millions de m3 ont été déstockés (85% du stock disponible), pour le soutien d’étiage de la Garonne, ce qui constitue un record (5).
Ces chiffres sont incontestables, mais il en est un autre que P. Trautmann s’est bien gardé de donner et que M. Bleuse (EELV) lui a très opportunément rappelé, en citant ce qu’il disait lors du conseil de métropole de décembre 2018 :
« Pour le reste, la consommation d’eau des 780 000 habitants de notre Métropole, des entreprises, notamment Airbus et des administrations, de tout le monde, c’est 0,5 mètre cube par seconde, quand l’étiage est à 50 mètres cubes par seconde. C’est 1 %. Donc qu’on ne parle pas de gestion de la préservation de la ressource. En période où nous sommes vraiment concernés, quand il y a l’irrigation, l’ensemble de l’eau potable représente 6% de la consommation totale d’eau. Donc s’il y a des choses à contrôler, ce n’est pas notre eau potable, même si nous devons faire des économies, même si nous devons colmater nos fuites… mais ce n’est pas chez nous que cela se joue. »
Alors pourquoi tant de tapage, de communication excessive, de dramatisation, si l’essentiel se joue ailleurs ? En particulier dans l’irrigation, ce que P. Trautmann se garde bien de dire. D’autant qu’il y a un autre chiffre que P. Trautmann ne présente pas dans son diaporama, mais qui est donné dans d’autres documents : en 2023, les économies d’eau sur la métropole ont déjà atteint entre 7 et 8%. C’est une baisse déjà considérable et elle appelle au moins quatre remarques :
Cette baisse est concomitante à une augmentation de la population, et donc la baisse par habitant est plus grande encore.
D’où vient une telle baisse, des usagers domestiques, des commerces, des industries, des administrations, des hôpitaux, ... ? En l’absence de statistiques plus précises, il est difficile de faire des projections sur les économies supplémentaires possibles. Il est piquant de remarquer que sur ce point P. Trautmann a enfin accédé à notre demande en rajoutant une diapo donnant les différentes consommations selon les secteurs d’usagers.
Avec près de 8% d’économies réalisées, nous sommes déjà quasiment à l’objectif de 10%, et qu’on devrait y parvenir sans trop de difficultés, d’autant plus qu’il y a d’autres leviers que la consommation pour réaliser des économies : fuites (mais le réseau est parmi les meilleurs de France avec moins de 15% de fuites),
Enfin, plus important peut-être, si les différents usagers ont déjà réduit globalement leur consommation de plus de 7% en 2023, c’est qu’ils sont très conscients des enjeux, et qu’il est assez insultant de les inciter à économiser encore plus par une mesure ayant, quoi qu’on en dise, un caractère punitif pendant cinq mois.
« Impact financier de la tarification saisonnière pour les ménages »
C’est le titre de la diapo 37. Pour un foyer de 3 personnes consommant 120 m3/an, la facture annuelle passerait de 400,5 € à 401,1 €, soit + 0,6 €.
Et pour ce même foyer consommant 250 m3/an (150 en été et 100 en hiver), la facture passerait de 820,9 € à 904,3 €, soit + 83,4 €.
En quoi cela inciterait les ménages du 1° type à économiser l’eau pour une si faible différence de facture ? D’ailleurs quelle économie d’eau en été conduit à cette estimation ? Et il est totalement illusoire de penser que le tarif d’été poussera aux économies d’eau pour des foyers avec jardin et piscine qui manifestement disposent de moyens financiers permettant d’éponger sans problème un supplément de 83€.
Par contre, il est assez méprisant de noter que le surplus de douches en été ne coûterait que 6€ de plus par an. Faire valoir des augmentations qui « ne sont que de quelques euros pas an », pour la baguette de pain, pour tel transport, tel médicament ou fourniture scolaire, etc, est particulièrement indécent vis-à-vis des personnes à faibles revenus.
Haro sur la tarification progressive
Toulouse Metropole a mis beaucoup d’énergie à combattre la proposition de tarification progressive que nous formulons depuis longtemps basée sur la gratuité des premiers m3 pour les particuliers et une tarification progressivement de plus en plus élevée-au delà, ainsi qu’un tarif différencié pour les entreprises, commerces, administrations, etc.
P. Trautmann consacre pas moins de dix diapos pour flinguer la tarification progressive, en s’appuyant sur l’avis du C.E.S.E. (6) de façon très abusive. Certes, la tarification progressive peut être assez complexe à mettre en oeuvre, et certaines villes y ont renoncé. Ce n’est pas pour autant que le C.E.S.E s’y oppose, il met seulement en avant les difficultés, et insiste sur le fait que la tarification progressive n’a pas fait la preuve de son efficacité pour réaliser des économies de consommation.
Quant à la tarification saisonnière, si elle est adaptée pour les villes de grand tourisme estival, elle n’a pas fait la preuve de son efficacité pour les autres villes. Le C.E.S.E. note :
« Mise en œuvre dans la Communauté de communes du Pays Fouesnantais (CCPF) elle a eu « pas ou peu d’impact » pour les résidents qui y vivent à l’année mais, qu’en revanche cela a permis une juste mise à contribution des résidences secondaires, hôtels, campings et résidences de vacances. »
Enfin, signe d’un certain malaise, la majorité pro-Moudenc, peu assurée de l’efficacité de la tarification saisonnière, a fini par adopter deux propositions - présentées par des groupes d’opposition - de « mise à l’étude » : d’une part de la tarification progressive avec gratuité d’un certain nombre de m3, d’autre part de l’objectif que chaque logement dispose d’un compteur individuel directement relié au distributeur (car il y a là une vraie difficulté pour la mise en œuvre de la tarification progressive dans nombreux logements collectifs ).
Le véritable enjeu : les contrats
On finit par se demander si tout ça n’est qu’un exercice pas très habile de communication, et si les véritables enjeux ne sont pas ailleurs. C’est ce qu’on signalé plusieurs élus (M. Perré, P. Lacaze).
Rappelons que lorsque en 2018 Toulouse Metropole a opté pour une délégation de service public (et non une régie) et conclu un contrat avec Veolia pour l’eau potable et Suez pour l’assainissement, celles ci avaient, pour obtenir le marché, proposé des offres très alléchantes garantissant un prix « très bas ». Mais pour tirer cette offre au plus bas, les concessionnaires avaient (entre autres) tablé sur une augmentation globale de la consommation d’eau !
Comme dit plus haut, la consommation globale est en baisse (et nous nous en réjouissons) et les filiales toulousaines SETOM/VEOLIA comme ASTEO/SUEZ se retrouvent en déficit !
Impossible juridiquement que Toulouse Métropole compense ces « manques à gagner « liés à la baisse de consommation .... A MOINS QUE ...A moins que celle-ci puisse être considérée comme consécutive à un changement induit par la collectivité elle même ! Et c’est ce que vient de permettre la mise en place de la tarification saisonnière.
Le 4 avril, 2 avenants ont été votés dans lesquels « Toulouse Métropole s’engage à compenser les baisses de volume à condition qu’elles soient directement imputables à la tarification saisonnière ». Ceci pour les baisses constatées les 3 prochaines années compensées jusqu’à la fin du contrat en 2032 !
Par ailleurs on ne nous fera pas croire que J.L. Moudenc a découvert les bienfaits de la tarification saisonnière la veille de son annonce à la presse fin novembre 2023. Autrement dit Moudenc, Medina et Trautmann auraient parfaitement pu préparer le dossier un peu avant de façon à instaurer la nouvelle tarification au 1° janvier 2024. Ainsi, sur l’année civile, les usagers auraient pu bénéficier des - 30% sur cinq mois avant l’augmentation de 42% au 1° juin.
Grace à cette mise en service le 1er juin, comme l’a reconnu par P. Trautmann, c’est environ 12 millions d’euros supplémentaires qui vont rentrer dans les caisses en 2024..
Et si, « juré promis », rien n’ira directement dans les caisses de Veolia et Suez, c’est bien une « cagnotte » qui a été constituée pour pouvoir compenser les baisses à venir !
On sait, comme l’ont souligné plusieurs élu.u.es, que les deux filiales se trouvent en difficulté. P. Trautmann a donné lui-même les chiffres : sur trois ans (de 2020, début de la DSP, à 2022) Veolia (eau) et Suez (assainissement) ont perdu respectivement 8,5 et 27 millions d’euros. Attention, il est normal qu’en début d’exploitation, les délégataires soient en déficit lié aux investissements de début de contrat, d’autre part comme nous l’avions qualifié lors de la signature du contrat l’offre de Veolia nous apparaissait « insincère » . En tout état de cause nous pouvons penser que grâce à la tarification saisonnière Toulouse Métropole et les 2 délégataires ont trouvé un terrain d’entente pour donner un bol d’air aux comptes des deux entreprises.
« Ils ont voté, et puis après ? »
Après ? Eh bien il faudra d’abord qu’au plus tôt, dès début 2025, soit tiré un bilan de cette nouvelle tarification. Et nous ne contenterons pas de statistiques générales : nous exigeons aussi le bilan des consommations mensuelles des trois dernières années, et si possible par type d’usagers.
Et nous serons très attentifs à l’utilisation de la "cagnotte" des 12 millions d’euros et en particulier aux demandes de compensations de Veolia et de Suez, ainsi qu’au résultat de la négociation quadriennale prévue dans les contrats.
Nous exercerons notre vigilance pour que l’engagement des deux mises à l’étude (tarification progressive et compteurs individuels) soit réellement tenu.
Et pour conclure ...
Ce débat sur une mesure qui peut apparaître de prime abord de caractère essentiellement technique, soulève toute une série de questions. Au fond, ce n’est pas surprenant tant les différentes dimensions de la problématique de l’eau s’entrecroisent de façon parfois très complexe : crise climatique, cycle de l’eau, raréfaction de la ressource, modèle agricole, qualité de l’eau, conflits d’usages, tarifications, état des réseaux, etc.
Or le modèle français est basé sur un principe qui semble intangible : « L’eau paie l’eau ». Ce principe est manifestement à bout de souffle, car il se heurte à des contraintes qui ne manqueront pas de s’accroître dans les années à venir. Plusieurs rapports récemment publiés attestent de la crise qui affecte la viabilité de ce modèle, et appellent à une refonte radicale des modalités de financement des politiques publiques de l’eau. L’un d’eux (7) souligne :
« D’autres facteurs vont aggraver le besoin d’investissement : renforcement des exigences réglementaires pour la qualité de l’eau potable et pour le traitement des eaux usées, investissements pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable face aux sécheresses... Alors que les charges des services d’eau sont majoritairement fixes, leurs recettes dépendent des volumes distribués. Or la consommation d’eau potable diminue de l’ordre de 1 à 2 % par an. Souhaitable, cette réduction se traduit pour les services d’eau par une diminution des recettes. Le modèle économique des services d’eau et d’assainissement n’est donc pas adapté à l’impératif de sobriété. Il est urgent de le réformer, dans le respect des principes d’équité, d’équilibre économique et de préservation de la ressource. »
Et le C.E.S.E. enfonce le clou : « Alors que les enjeux environnementaux actuels dépassent la tarification des services de l’eau potable, le CESE réinterroge donc le principe de « l’eau paie l’eau » en alertant sur la fin d’une eau « bon marché » à court ou moyen terme. »
Dans ce cadre, il ne fait aucun doute que Veolia et Suez s’arc-bouteront sur la défense de leurs privilèges, tant les délégations de services publics, dans le cadre de « l’eau paie l’eau », leur ont permis d’engranger de juteux bénéfices.
Alors qu’une tendance de fond en faveur de la gestion publique de l’eau se dessine ces dernières années dans de nombreuses collectivités locales, un débat sur la remise en cause du principe de « l’eau paie l’eau » nous semble nécessaire, et devrait renforcer les arguments en faveur d’une régie publique. A Toulouse comme ailleurs.
Notes :
(1) Toulouse-Métropole compte 37 communes et plus de 800 000 habitants dont plus de 500 000 à Toulouse.
(2) P. Trautmann, en charge de la commande publique, principal acteur de la politique de l’eau ; R. Medina, maire de Mondouzil, vice-président délégué à l’eau et l’assainissement.
(3) Commission Consultative des Services Publics Locaux, où siège ES 31, aux côtés d’autres associations et d’élu.e.s.
(4) Voir l’excellent article de l’O.F.B. : « questions-réponses sur les inondations ».
(5) Ces volumes sont achetés à EDF par le S.M.E.A.G (Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne), dirigé par la majorité P.S. du Conseil départemental.
(6) Conseil Economique Social et Environnemental.
(7) https://www.intercommunalites.fr/app/uploads/2024/03/2024_dossier-de-presse-eau-V5.pdf
L’actualité récente de la lutte contre les PFAS ressemble étrangement au mouvement des agriculteurs du début d’année 2024. D’un côté, la santé des gens malmenée face à la dissémination de produits chimiques dans les corps vivants. De l’autre, la défense des activités économiques, dont l’immense et précieuse productivité dépend de l’utilisation de ces produits. Défense qui conduit à relativiser la pollution, et à demander toujours plus d’études et de « preuves » que ces produits chimiques sont effectivement nocifs - preuves qui n’auront pas, on le sait bien, comme conséquence l’interdiction des dits produits, mais qui y contribueront... un jour.
De façon spectaculaire, afin de sauvegarder leur activité économique menacée par un projet de loi contre les PFAS, des salariés - auxquels leur patron avait offert un jour de congé - se sont rendus à la capitale pour manifester contre ce projet de loi.
On ne saurait toutefois ramener une telle manifestation au pouvoir des dirigeants de cette entreprise. C’est en toute bonne foi que des agents économiques défendent leur gagne-pain, avant toute autre chose. Et quand ils demandent des "solutions", ils ne demandent pas des solutions techniques (pour se passer d’un produit chimique problématique), mais des solutions économiques. Et immédiates.
Comme dans l’agriculture, face à la pollution, la question n’est pas de savoir s’il est techniquement possible ou non de "moins polluer", toute chose égale par ailleurs. On le sait bien : dans l’absolu, l’humanité peut vivre sans PFAS, sans pesticides.
Mais dans une société marchande, ce n’est pas possible. Ne pas utiliser ces produits chimiques, c’est ne pas pouvoir produire industriellement les marchandises dont la norme de productivité impose, pour le marché mondial, de les utiliser. Ne pas utiliser d’insecticides c’est, pour un agriculteur, ne pas produire.
Ne pas utiliser de PFAS, c’est ne pas pouvoir produire. Ne pas vendre, ne serait-ce que sur une courte période de temps, c’est arrêter de produire, donc détruire les précieux emplois rémunérés (car des besoins non rémunérables et non répondus, il y en a pléthore).
Le quiproquo est donc permanent et la confusion totale, puisque d’un côté, on fait semblant de débattre pour savoir si un produit chimique est "essentiel" pour tel ou tel usage. Alors qu’en réalité, seul le critère de rentabilité, au principe de toute activité économique, compte véritablement. Quand le député Nicolas Thierry arrive avec sa proposition de restriction des PFAS, il a en amont vérifié, non pas qu’il existe une "alternative" aux PFAS, mais que le tissu industriel a déjà réussi à s’en passer, en restant compétitif sur le marché.
Autrement dit, la possibilité d’une loi de restriction des polluants ne vient qu’en deuxième, une fois que l’appareil industriel a déjà pu mettre en place une alternative rentable. La manifestation des salariés de l’entreprise SEB utilisant des fluoropolymères, aboutissant à retirer du périmètre d’interdiction l’activité de leur entreprise, n’est qu’une confirmation de cette loi sociale fondamentale des sociétés marchandes mondialisées : aucune norme sociale ne sera plus forte que celle émanent du champ économique.
Les débats politiques, les "responsables" politiques, n’ont pas d’influence sur cette loi et il est problématique de prétendre le contraire : on ne fait que reculer la prise en compte du blocage profondément marchand qui empêche d’agir efficacement contre les pollutions. Ce que l’on demande à un "responsable" politique c’est avant tout de respecter cette loi et toute tentative de sortir du cadre donnera lieu à une réponse rapide et sans ambiguïté du champ économique. Et ce ne sont pas toujours les grandes figures capitalistes que sont les patrons qui se donnent la peine de s’exprimer quand une ligne rouge est franchie (par une simple tribune dans un journal économique il est possible de décourager un ministre de mener une politique contre des intérêts économiques). Toute la société est impliquée dans le mouvement tautologique de l’argent désormais mondial, puisque c’est lui qui fait travailler les gens et leur donne un revenu, et qu’aucun besoin ne saurait être répondu sans en passer par une activité rémunérée.
Mais également, c’est tout l’appareil d’Etat et ses services qui sont nécessairement impliqués dans la défense du statut quo marchand, et donc des pollutions, puisque c’est le mouvement de l’argent qui permet à l’Etat de fonctionner, et c’est le développement de l’Etat qui a historiquement imposé aux sociétés de devenir marchandes de bout en bout, c’est-à-dire capitalistes. On ne comprendrait pas, autrement, pourquoi les services de l’Etat chargés de protéger la population et l’environnement sont si peu zélés à intervenir sur les activités industrielles, et minimisent systématiquement l’importance des pollutions induites, qu’il s’agisse des pollutions chroniques pas même prises en compte, que des pollutions bien plus visibles et médiatisées lors d’accidents industriels.
Sans avoir en tête cette loi sociale fondamentale, il est difficile de comprendre pourquoi l’utilisation de produits toxiques se développe toujours plus, et pourquoi les politiques comme la société en général sont si impuissants à reprendre en main leur destinée - pour avoir confié celle-ci au fétiche monétaire, et son corollaire, le travail humain soumis intégralement à son mouvement.
Se satisfaire d’une loi minimale qui prétend avoir agi sur la source du problème, en dédouanant totalement l’activité industrielle dans sa nature marchande même, alimente la confusion dans la tête des gens et nous éloigne radicalement de solutions réelles pour stopper net les pollutions chimiques et l’accélération du désastre qu’est la production marchande planétaire.
S’attaquer par le petit bout de la lorgnette aux pollutions, au cas par cas, sans s’interroger sur les causes globales, en ne traitant les problèmes que sous le prisme de la « volonté politique », c’est au contraire manquer de courage, et participer à la cogestion de la crise du capitalisme dans l’intérêt supérieur de la société marchande et de la poursuite du mouvement tautologique de l’argent, qui impose de mettre en second plan tous les autres aspects de la vie, y compris sa préservation face aux pollutions chimiques contre lesquels ces "responsables" politiques entendaient lutter.
Toutes les personnes qui luttent contre les PFAS savent que, si il y en a partout, c’est parce que "c’est pratique et pas cher" - et non parce que le personnel politique de tel ou tel pays n’aurait pas fait voter la bonne loi. Mais bien peu sont choqués qu’un tel critère, dans toute son indigence, gouverne tout bonnement la présence des objets qui nous entourent, et pas seulement ceux comportant des PFAS.
Au lieu de lutter contre chaque pollution séparément, et perdre les gens à cause de l’expertise qu’il faut déployer à chaque fois pour discuter du degré acceptable de toxicité, on ferait mieux d’adopter une toute autre stratégie de lutte. Puisque l’indigence du critère monétaire gouverne également toutes les autres nuisances (du réchauffement climatique à l’accumulation des déchets plastiques), et qu’aucune entente mondiale ne viendra réglementer le commerce mondialisé par le haut, être réellement écologiste implique d’être également post-monétaire afin d’amener l’impensable à être pensé : sortir de la torpeur marchande pour une toute organisation sociale et répondre enfin décemment à nos besoins. Comment le faire ? Puisse le caractère "éternel" de ces polluants être suffisamment choquant pour provoquer cette nécessaire discussion. »
(*) Deun est le pseudonyme de l’un des contributeurs au site de micro-blogging Seenthis.
La nouvelle ministre déléguée aux Outre Mer accompagnait Gérard Darmanin en Guadeloupe, où ce dernier a annoncé un couvre feu pour les mineurs à Pointe à Pitre. Ne connaissant rien à la crise de l’eau qui sévit dans l’ile, la nouvelle ministre a enjoint les Guadeloupéens à payer leurs factures s’ils veulent avoir de l’eau. Une saillie méprisante dénoncée dans une lettre ouverte assassine par deux représentants des usagers, dont l’un membre du Comité de surveillance du SMAEAG, le nouveau syndicat mixte créé par l’Etat en 2021, en place de son prédécesseur failli le SIEAAG, qui se révèle tout aussi incapable de conduire sa mission à bien.
« Madame la Ministre déléguée,
Une fois de plus, un représentant de l’Etat vient nous infantiliser, alors que vos propos sont le reflet de votre ignorance des réalités dans ce domaine du secteur public, ou vous venez nous demander, de payer 80% du montant des factures émises, alors que le SMGEAG n’a comme recette que 64% de la facturation, souventes fois insincère, et que vous feignez d’ignorer, que payer une fourniture non conforme relève de l’abus de droit et que nous sommes fondés, à apliquer l’exception d’inexécution, de par : les tours d’eaux, pour diverses raisons, dont les non conformités pour des raisons plurielles, excès d’aluminium, turbidité, présences de bacilles, de coliformes fécaux, excès de chlore, présence de pesticides dilués, ce qui est coutumier dans l’eau agricole qui est la variable d’ajustement de l’eau potable avec toutes ces irrégularités opérationnelles dont l’absence de DUP,.etc.
Ce propos, madame la Ministre déléguée est inacceptable, et démontre le peu de soucis, voire le mépris que vous avez pour nos populations, à qui vous venez de dire : si vous voulez un réseau d’eau potable, vous n’avez qu’à vous le payer vous même en payant les factures émises. Ignorez vous donc les irrégularités et manquements chroniques où le volume prélevé est 4 fois supérieur à celui réellement consommé voire facturé, ce qui est formellement interdit par la loi.
Et pourtant vos « mis à disposition » (des représentants de l’Etat détachés par Paris qui assurent la tutelle du syndicat, NDR), ne dénoncent ni ne corrigent cette anomalie.
Que dire de cette anomalie qui sert de base au prélèvement de la taxe de l’Office de l’eau (ODE 971), dont le DGD mis à disposition pâr l’ODE 971, n’a pas mission de recouvrer cette taxe, que pourtant il prélève sans pourtant la reverser à son destinataire, alors que destinée à la restauration des millieux endommagés. Ce qui relève du pénal, en tant que prélèvements pour compte de tiers, qu’il a moratorisé, sans pourtant en payer la 1° échéance, ce qui rend exigible l’intégralité de la créance et taxes additionnelles et induit l’aggravation indue de l’octroi de mer interne et de l’assiette de la TVA.
Que dire de l’appauvrissement chronique des défavorisés, contraints quotidiennement d’acheter de l’eau en bouteille plastique, que l’on n’arrive pas à collecter pour les détruire ce qui appauvrit nos compatriotes en réduisant leur pouvoir d’achat alors que sur un archipel où le taux de chômage est de 37%, tout ceci conforte l’aggravation des ressentis des usagers, tout en polluant l’environnement, alors que la fourniture d’eau relève des mesures compensatoires incombant au SMGEAG.
Que dire de la chlordécone, notre Tchernobyl local se traduisant par des siècles de transmission de maladies génétiques transmises, sans omettre le surcout des filtrations adéquates avec écretage en tête, remplacée pour des raisons économiques par des filtres à sable, et le traitement au charbon actif, coutant de plus en plus cher, ceci s’ajoutant au champ de mines des fosses septiques devenues puisards, n’assurant plus de fonctions épuratives.
Que dire du silence bruyant du service réclamations du SMGEAG, aggravant le ressenti des usagers. D’autant que votre DGD est incapable de faire face à l’ampleur de la tâche qui lui a été confié, témoignage de l’incompétence chronique de la politique que vous poursuivez sans vous être adressée aux usagers, encore moins les écouter.
Pour débuter, nous répondrons à votre mépris, par un boycott des paiements des factures, conformément aux dispositions que nous permet le droit de notre état, de par l’exceptio non adeniplete contractus et dégageons d’ores et déjà toutes responsabilités sur les réactions diverses de nos usagers, notamment les plus défavorisés qui subissent, l’outrage de la suffisance de ceux des agents du SMGEAG, qui entretiennent cette engeance, que nous n’acceptons plus.
Nous vous rappelons que nous sommes aussi citoyens-électeurs, donc non complices des taiseux complices actifs et passifs de l’héritage que vous acceptez. et nos réactions prochaines s’ajouteront à notre campagne de non paiement.
Sachez que chez nous quand vous semez de manière méprisante les causes du réveil de pesanteurs d’histoires, vous plantez aussi une graine de vent ou vous verrez pousser un arbre cyclone. Vous assumerez les conséquences de vos choix.
Bonne réception. »
Jacques Davila et Germain Paran, secrétaire général de CDUEG
Interrogé par un sénateur, le ministre de la Transition écologique rappelle le dispositif que l’état entend déployer dans les Drom pou faire face au recul du trait de côte.
La question de M. Dominique Théophile (Guadeloupe - RDPI) publiée le 11/04/2024 :
« M. le président. La parole est à M. Dominique Théophile, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
M. Dominique Théophile. Ma question s’adresse à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Monsieur le ministre, le 8 mars 2024, l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (Igedd) publiait un rapport sur les conséquences du recul du trait de côte. Ce rapport, bien que déjà très alarmant, a été complété la semaine dernière par celui du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema).
Les chiffres qui en ressortent font froid dans le dos. En 2028, environ un millier de bâtiments pourraient être touchés par le recul du trait de côte à l’échelle nationale. Encore pire, en 2050, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec), le niveau de la mer aura augmenté d’un mètre ; à cette même échéance, le Cerema estime que 5 200 logements et 1 400 locaux d’activité, représentant une valeur totale de plus de 1,2 milliard d’euros, pourraient être affectés par ce recul.
Ces scénarios illustrent les possibles conséquences de l’inaction face aux effets du changement climatique, qui obligeront nombre de nos compatriotes de l’Hexagone comme des outre-mer à changer de logement ou à l’adapter.
Parmi les personnes les plus affectées figurent les habitants de mon département, la Guadeloupe, où 500 foyers, composés majoritairement de personnes âgées, voient leur vie menacée du fait de leur exposition aux phénomènes climatiques naturels.
Dans le cadre de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat et Résilience, le Gouvernement a instauré un nouvel instrument, le bail réel d’adaptation à l’érosion côtière, afin d’accompagner ces familles et de les aider à se reloger. Toutefois, ce bail concerne avant tout les propriétaires. Or la majorité des victimes de l’érosion en Guadeloupe ne le sont pas ; elles ne peuvent donc pas bénéficier de ce dispositif de droit commun.
Monsieur le ministre, face à l’ampleur de ces scénarios, l’anticipation s’impose. Les acteurs locaux sont déjà prêts et engagés, mais ils ont besoin de ressources.
Quelles sont les mesures prévues pour les accompagner et rendre le relogement de ces familles le moins pénible possible ? Quelles actions l’État mettra-t-il en place pour mieux appréhender ce phénomène et renforcer l’information des acquéreurs comme des locataires ? (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.) »
Publiée dans le JO Sénat du 11/04/202.
La réponse du Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires publiée le 11/04/2024 :
« Réponse apportée en séance publique le 10/04/2024
M. le président. La parole est à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
M. Christophe Béchu, ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Monsieur Théophile, compte tenu de votre engagement en faveur de la sauvegarde des récifs coralliens, des départements et régions d’outre-mer (Drom) de façon générale, et de la Guadeloupe en particulier, je ne suis pas surpris que vous me posiez cette question véritablement d’actualité. En effet, le Cerema a publié la semaine dernière les cartes aux horizons 2030, 2050 et 2100 des départements les plus touchés par la montée des océans, ainsi que les scénarios qu’il envisage.
La première raison pour laquelle mon ministère a commandé cette cartographie et fait en sorte qu’elle soit publiée est exactement la même que la vôtre lorsque vous m’interrogez sur ce sujet : il s’agit de favoriser la prise de conscience. Car 2050, ce n’est pas si loin !
En 2050, plus de 5 000 logements seront touchés par le recul du trait de côte et, sur ce nombre, 10 % se situent en Guadeloupe. Il est donc nécessaire d’examiner précisément l’évolution de ce phénomène sur votre territoire.
Une mission d’inspection spécifique aux outre-mer est en cours, afin d’étudier de manière plus fine la typologie particulière des habitats ultramarins. Dans l’Hexagone, on observe une surreprésentation des propriétés et des résidences secondaires parmi les 20 % d’habitations les plus touchées sur le littoral. Ce n’est pas nécessairement le cas partout, comme vous l’avez dit.
Très concrètement, le plan national d’adaptation au changement climatique, qui sera présenté dans les prochaines semaines et que connaît bien le sénateur Dantec, comprend un volet consacré à la montée des océans. Quant au projet de loi de finances pour 2025, il prévoira les dispositifs d’accompagnement budgétaire nécessaires.
La mission confiée à la députée Sophie Panonacle vise à définir, en concertation avec l’Association nationale des élus du littoral (Anel), et en particulier le maire des Sables-d’Olonne, la meilleure répartition possible des financements dédiés à l’information, à l’indemnisation et à la capacité de construction en zone rétro-littorale.
Voilà ce à quoi nous travaillons, avec un impératif : ne pas rester dans l’inaction.
Dans certains endroits il faudra construire des digues ; dans d’autres, il faudra replanter des mangroves ; et, dans d’autres encore, il faudra éviter de mener un combat perdu contre la mer, selon ce que nous diront les experts.
Vous aurez l’occasion de vous exprimer très rapidement sur cette panoplie de mesures que nous envisageons, qui vont de l’étude des phénomènes à l’indemnisation. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur des travées du groupe INDEP.) »
Une note d’analyse de France stratégie.
Dans sa nouvelle publication, France Stratégie aborde la question de la ressource en eau renouvelable, nécessaire aux différents usages anthropiques et au fonctionnement des milieux aquatiques. Cette ressource a diminué de 14 % en France au cours des quinze dernières années et cette tendance pourrait s’accentuer, à certaines périodes de l’année et sur certains territoires, en lien avec le changement climatique. Pour documenter ce phénomène, les auteurs établissent un panorama des prélèvements et des consommations selon son utilisation finale. Une première étape d’un travail plus large de prospective sur les usages de l’eau à horizon 2050, réalisé à la demande du Premier ministre et qui sera publié à l’automne 2024.
Une analyse plus fine des usages finaux de l’eau
Quel est l’état actuel des connaissances de la demande en eau ? Quelles sont les dynamiques spatiales de cette demande ? En distinguant les notions de prélèvements et de consommation - c’est-à-dire la part des prélèvements ne retournant pas directement aux milieux - les auteurs établissent un panorama selon son utilisation finale, à un niveau plus fin que les statistiques usuelles. Sur les 30 milliards de mètres cubes prélevés en 2020 en France hexagonale et en Corse, 47 % sont imputables au secteur énergétique, essentiellement pour le refroidissement des centrales électriques. Ces prélèvements pour l’énergie sont particulièrement élevés dans le bassin versant de Rhône-Méditerranée en raison de la présence de centrales nucléaires en circuit ouvert.
Une réévaluation de la consommation en eau
Les « facteurs de consommation », qui permettent de passer des prélèvements à la consommation ont été réévalués. Par exemple, s’agissant de l’industrie, ils ont été revus de 7 à 17 %. La consommation d’eau de l’industrie reste nettement plus faible que celle liée à l’irrigation agricole (9 % du total contre un peu moins des deux tiers). Au-delà de l’irrigation pour des cultures destinées à l’alimentation humaine, l’irrigation pour des cultures destinées l’alimentation animale y contribue significativement.
Une première estimation du phénomène d’évaporation lié au stockage de l’eau
L’analyse aborde la question des stockages d’eau artificiels (hydroélectricité, retenues agricoles, plans d’eau d’agrément...), qui ne sont aujourd’hui pas considérés comme consommateurs d’eau. Une première estimation du phénomène d’évaporation montre qu’ils pourraient engendrer une consommation de l’ordre d’un milliard de mètres cubes par an, élevant donc la consommation annuelle totale à 5,4 milliards de mètres cubes.
Lire la note et sa notice méthodologique :"
https://www.strategie.gouv.fr/publications/prelevements-consommations-deau-enjeux-usages
Grapheal, une startup « Deeptech », spécialisée dans les biocapteurs, et le laboratoire EDYTEM, une unité mixte de recherche CNRS/Université de Savoie-Mont Blanc, annoncent la mise au point au sein de leur laboratoire commun « Fluorograph » de capteurs portables pour surveiller la pollution de l’eau aux PFAS. Ces capteurs miniatures sont capables de mesurer directement sur le terrain les traces de pollution liées aux composés per- et polyfluoroalkyles (PFAS) présents dans l’eau.
Les PFAS constituent une famille d’environ 12 000 molécules aujourd’hui utilisées dans un très grand nombre d’applications et dispositifs en raison de leurs propriétés uniques.
Un grand projet cartographique a montré qu’on les retrouve dans des milliers de sites en Europe. Du fait de leur exceptionnelle persistance, de leur toxicité et de leur (bio) accumulation, les PFAS sont désormais qualifiés de "polluants éternels". Ils sont à l’origine de problèmes de santé et de dommages environnementaux importants. Pour ces raisons, la détection des PFAS à l’état de traces et leur suivi sont devenus une priorité mondiale. Actuellement, l’évaluation de la contamination des sources d’eau par les PFAS est très complexe et nécessite des analyses en laboratoire utilisant des équipements sophistiqués et coûteux.
Pour répondre à cette problématique, le laboratoire Fluorograph a mis au point un capteur électronique miniature (de la taille d’une carte de crédit) capable de réaliser ces tests directement sur le site de prélèvement, simplifiant considérablement la réalisation des cartes de contamination. Les premiers résultats des tests issus de ces nouveaux capteurs sur la détection dans l’eau d’une des molécules de PFAS les plus communes, le PFOA (acide perfluorooctanoïque), ont montré des seuils de détection de l’ordre de 300 ng/L, c’est-à-dire en dessous du seuil règlementaire de l’Union Européenne autorisant au maximum 500 ng/L de PFAS dans l’eau potable.
« La sensibilité élevée et la simplicité d’usage du capteur Fluorograph vont permettre de détecter de manière quantitative les PFAS directement sur site et de satisfaire la forte demande de cartographier les zones polluées et de suivre leur évolution, » indique Guy Royal, chercheur à EDYTEM. « C’est un outil précieux pour les chercheurs de terrain, les organismes de réglementation et le personnel chargé de la gestion de l’eau. »
« Parce qu’il est produit par électronique imprimée et fait appel à un capteur en carbone, son impact environnemental est très réduit » ajoute Vincent Bouchiat, président de Grapheal. « L’analyse sur le point de prélèvement va créer une réelle simplification logistique, il va permettre d’augmenter la densité des tests tout en réduisant significativement la charge financière liée aux analyses fréquentes de l’eau. Dans ce cadre, Grapheal recherche des partenaires industriels afin d’accompagner l’industrialisation de sa solution et la montée en volume de sa production. »
Grâce à ces premiers résultats, le laboratoire commun Fluorograph se positionne comme un acteur de premier plan dans le domaine des solutions de surveillance de l’environnement, capable de relever les défis émergents en matière de qualité de l’eau et de lutte contre la pollution. Ce dispositif de mesure électrochimique constitue une avancée marquante pour la science environnementale et la santé publique. En mettant l’accent sur la recherche, la durabilité et le déploiement de nanotechnologies respectueuses de l’environnement, il pourrait avoir un impact positif sur les écosystèmes et les communautés du monde entier.
– Grapheal est une startup « Deeptech », spécialisée dans la réalisation et l’industrialisation de biocapteurs numériques rapides et sensibles à base de nanodispositifs électrochimiques propriétaires. Créée en 2019 en essaimage du CNRS, elle est dirigée par les scientifiques à l’origine des technologies mises en œuvre depuis 2010 à l’Institut Néel du CNRS de Grenoble. Les dispositifs développés sont basés sur de nouveaux matériaux carbonés permettant la détection à haute sensibilité de marqueurs chimiques et biochimiques et sont destinés à s’interfacer facilement avec des technologies mobiles telle que le smartphone. Ces innovations ont été récompensés par de nombreux prix, notamment un « Best-off innovation award » au CES de Las Vegas en 2022.
– Le laboratoire EDYTEM (Environnements, DYnamiques et TErritoires de la Montagne), associant l’Université Savoie Mont Blanc et le CNRS, étudie les environnements de montagne en combinant sciences de la Terre, du vivant, et sciences humaines. Il se concentre sur la biodiversité, les impacts du changement climatique, et le développement durable des territoires de montagne. À travers une approche interdisciplinaire, EDYTEM vise à comprendre les dynamiques naturelles et humaines des montagnes pour y promouvoir une gestion durable. Collaborant avec des partenaires et des compétences scientifiques très variées, ses recherches contribuent à la conservation des écosystèmes montagneux et à leur adaptation aux défis environnementaux et sociaux dont notamment la qualité de l’eau. L’Université Savoie Mont Blanc (USMB) compte 18 laboratoires de recherche qui déploient leur expertise sur trois grands axes thématiques : « Interactions Homme environnement », « Services et industries du futur », et « Patrimoine culturel et société en mutation ».
À 108 jours du début des Jeux olympiques de Paris, une nouvelle étude menée par l’ONG Surfrider Fondation, consultée par France Inter, révèle que la Seine n’est toujours pas adaptée à la baignade. Plusieurs prélèvements réalisés à Paris depuis septembre 2023 indiquent la présence de plusieurs bactéries à des niveaux qui dépassent les normes fixées par la Fédération internationale de natation.
Ils ont l’air malins tous les ravis de la crèche, Hidalgo, Macron, Le Monde, Libération, Brut, qui rivalisent dans le déni à qui mieux mieux, et relaient en boucle les mensonges extravagants diffusés depuis dix ans autour de ce qui demeurera comme un cas d’école de la manipulation de l’information.
Ici nul besoin d’invoquer les fermes à trolls de Saint-Petersbourg, le FSB, le SVB, le GRU et les « cyberattaques » qui menacent la civilisation occidentale jusque dans nos collèges…
L’ensemble des « élites » concernées mentent effrontément et s’étonnent dans le même temps du discrédit qui les frappe. Eclairant.
L’ONG Surfrider Fondation a réalisé elle-même, depuis le mois de septembre 2023, des prélèvements réguliers, au niveau du Pont de l’Alma et du Pont Alexandre III, là où doivent justement se dérouler les épreuves de natation marathon, de triathlon et de paratriathlon lors des olympiades de Paris l’été prochain.
Ces prélèvements ont été réalisés en partenariat avec le laboratoire Eau de Paris (le même que la mairie de Paris) et Analy-Co, « aussi bien à la suite de fortes pluies que par des journées ensoleillées ».
Parmi les 14 prélèvements réalisés, 13 révèlent la présence de bactéries
Parmi les 14 prélèvements réalisés, 13 révèlent la présence de certaines bactéries, notamment l’Escherichia coli et les entérocoques, à des niveaux supérieurs aux normes définies par la Fédération internationale de natation. Les seuils de qualité de l’eau se dégradent particulièrement après des épisodes pluvieux de très forte intensité qui font saturer les égouts et poussent à des rejets d’eaux usées dans la Seine.
Les analyses effectuées par Surfrider montrent des concentrations en E. coli régulièrement supérieures à 2 000 ufc/100 ml (maximum de 7 250 sous le pont de l’Alma le 7 février) et à 500 ufc/100 ml pour les entérocoques (maximum de 1 190 à la même date). Face à ces résultats « alarmants », Surfrider exprime ses « inquiétudes croissantes quant à la qualité des eaux de la Seine » et pointe les « risques » pour les athlètes, et au-delà pour les Franciliens, « à évoluer dans une eau contaminée ».
"On est deux à trois fois au-dessus des normes minimum impératives pour une pratique saine des athlètes pendant la saison", alerte Marc Valmassoni, Coordinateur de campagne chez l’ONG. Une présence bactériologique qui a des conséquences potentiellement graves pour les athlètes : "En termes sanitaires, ils sont exposés à des pathologies comme la gastro-entérite, la conjonctivite, l’otite ou des problèmes cutanés."
Le mois dernier, le préfet de la région Île-de-France avait réaffirmé qu’il n’y avait "pas de plan B" pour ces épreuves de natation en eaux libres en cas de pollution de la Seine. La mairie de Paris compte sur le nouveau bassin de rétention, tout près de la gare d’Austerlitz, pour stocker les eaux de pluie, mais pour l’ONG, spécialiste des eaux de baignade, ce ne sera peut-être pas suffisant.
"Ça laisse une chance s’il y a des épisodes pluvieux modérés", précise Marc Valmassoni, mais "le bassin ne pourra pas stocker l’ensemble du ruissellement si un évènement pluvieux est très important. Donc, à partir du moment où il sera en incapacité de tout stocker, les eaux supplémentaires vont complètement ruisseler ou se déverser dans la Seine et vont avoir un impact sur la qualité bactériologique" du fleuve.
D’ici les Jeux olympiques, Surfrider Fondation veut continuer ses prélèvements pour vérifier la qualité de l’eau en toute transparence.
Lire aussi :
– Royaume-Uni : l’état peu reluisant de la Tamise révélé par la course Oxford-Cambridge
France info, 8 avril 2024.
– Baignades en Seine et JO 2024 : quand la fable tourne au fiasco
https://blog.mondediplo.net/baignades-en-seine-et-jo-2024-quand-la-fable
Carnets d’eau, Le Monde diplomatique, 8 août 2023.
Il manque actuellement 250 m3 d’eau à distribuer par heure sur le Feeder de Belle eau cadeau (la conduite principale de l’ile). Ce à quoi s’ajoutent d’importantes fuites d’eau. Le SMGEAG annonce le retour de tours d’eau obligatoires et « solidaires ». Les explications de Marcus Agbekodo, le directeur délégué à la radio RCI.
À cause de la sécheresse, c’est le retour des tours d’eau dans de nombreuses communes de Guadeloupe. Il manque 250 mètres cube d’eau par heure à distribuer sur le réseau du SMGEAG (Syndicat Mixte de Gestion de l’Eau et de l’Assainissement en Guadeloupe).
Le réseau est aussi impacté par des fuites importantes. Conséquences immédiates : des foyers situés sur les hauteurs des Abymes, de Gosier, de Goyave et de Saint-François sont privés d’eau régulièrement.
Marcus Agbekodo, le directeur délégué du SMGEAG, s’en explique :
« Les tours d’eau sont des tours d’eau solidaires. Chaque semaine, on envoie un planning des tours d’eau. Ceux qui sont dans les hauteurs, aux Abymes, au Gosier ou à Goyave par exemple ont manqué d’eau car il n’y a pas assez de pression pour les alimenter. C’est ce qui se passe aussi à Saint-François où il y a très peu d’eau dans le réservoir. Il y a des quartiers de Saint-François qu’on ne peut pas alimenter. La situation va durer encore un an, voire deux car la situation est vraiment très dégradée. Et quand je n’ai pas d’eau, je ne peux pas l’inventer. Il faut aujourd’hui trouver de nouvelles ressources et renouveler massivement les réseaux pour ne pas perdre de l’eau. »
Selon le SMGEAG, la Guadeloupe ne souffre pas de déficit hydrique. « La preuve, il pleut beaucoup ». Mais, en période de sécheresse, assure-t-il, vu la perte dans les tuyaux, l’eau n’arrive pas au robinet pour tout le monde. À Saint-François, ce serait au moins 60% d’eau qui serait perdue.
Contexte : le nouveau syndicat mixte créé en 2021 après la faillite de son prédécesseur dysfonctionne toujours allégrement. Soutenu financièrement à bout de bras par l’AFD et la Banque des territoires qui y injectent plusieurs dizaines de millions d’euros chaque année pour assurer les fins de mois, il est dans l’incapacité de remettre en état un réseau qui demanderait un milliard d’euros d’investissement.
Idem pour l’assainissement, totalement défaillant.
L’ARS estime que dans dix ans on ne pourra plus se baigner en Guadeloupe.
Le secteur du tourisme s’émeut.
Les autorités appliquent le mot d’ordre immuable venu de Paris : PAS DE VAGUES…
Le Président de Rhône-Sud, le syndicat producteur d’eau potable géographiquement proche d’Arkema, et de ce fait gravement impacté par la pollution aux PFAS, a interrogé le Premier Ministre sur le financement du traitement de la pollution de l’eau potable par les PFAS. Selon le Président de Rhône-Sud, 10 M€ seront nécessaire pour la mise en place du traitement par le charbon actif
Comme cette pollution vient quelques années après d’autres pollutions, elles-mêmes très couteuses, une aide de l’Etat a été sollicitée en direction du Premier Ministre.
Toute une chaine administrative aurait même autorisé le pollueur Arkema à rejeter ses effluents pollués dans le Rhône. Ce qui au passage dégage Arkema de toute responsabilité dans l’affaire.
Est-ce par maladresse, que ce même président aurait avancé la faute de l’Etat qui aurait autorisé Arkéma à rejeter ses effluents pollués dans le Rhône, pour demander l’aide financière de l’Etat ?
Dans son allocution, le Président de Rhône Sud a stigmatisé la Préfecture qui l’avait renvoyé vers l’ARS, accusant la Préfète d’avoir mal défendu les victimes de la pollution.
Réponse de la Préfète : l’accusation du pollueur devant la justice aurait échoué, car il n’y avait pas de règlementation interdisant les rejets, et la plainte aurait de ce fait abouti à un rejet de l’accusation.
Elle a également insisté sur le fait que la pollution aux PFAS n’était pas que locale mais « qu’elle existait de partout ». « Qu’elle était même mondiale ».
Attal a défendu la Préfète en disant que l’administration ne faisait qu’appliquer les directives du gouvernement et donc celles de l’Etat. Etat qui de ce fait prendrait sa part financière pour mettre en place le traitement de l’eau.
Une solution a même été avancée par la Préfète. Le financement d’une installation de traitement sera aidé par l’Agence de l’Eau dont elle est membre dirigeante (vice-présidente ?).
Personne ne s’est opposé à cette solution qui renvoie la charge de la réparation d’une pollution dont on connaît le fautif, Arkema, vers les usagers de l’eau qui financent l’Agence de l’Eau à 85 %.
Au passage, comment accepter sans sourciller la mise hors cause du pollueur par le fait qu’il aurait été autorisé par l’Etat à rejeter sa pollution dans le Rhône ?
Le Premier Ministre a très mal, voire pas du tout, présenté de solution au problème des PFAS. Inacceptable : il a validé la pire des solutions qui renvoie le coût du traitement d’une pollution dont on connaît le fautif, sur la facture d’eau des usagers, via l’Agence de l’Eau RMC.
Répétons pour l’avoir tous bien en tête, que l’Agence de l’Eau est financée à 85 % par les usagers domestiques via leur facture d’eau !
Ces usagers domestiques, qui sont les seuls à traiter leurs eaux usées, en plus de la pollution agricole par les pesticides, vont-ils être surfacturés de la réparation d’un préjudice industriel dont ils ne sont pas responsables ?
Peut-on accepter sans réagir de voir Rhône-Sud, la Préfecture, et même le Premier Ministre, dégager de fait la responsabilité d’Arkema, et charger les usagers de la réparation financière d’une faute dont ils ne sont pas responsables ?
La contribution involontaire des usagers payeurs ne dépolluera que l’eau mise en réseau AEP mais ne traitera pas la pollution environnementale en cascade de l’usine au fleuve et à la mer... dont on ne mesure pas les conséquences avec ces polluants éternels.
Les faits répétés et trop fréquents exercent une pression de pollution chronique qui dégrade durablement les mieux.
« Il s’agit notamment de la pollution des eaux observée dans le Golfe du Morbihan (entre Baden et l’île aux Moines) au début février 2024, ou de la pollution par les boues de station d’épuration de Landaul, observée depuis décembre 2023. Quoique l’association se soit rendue trois fois sur place, aucune action de remédiation (remise en état) du site n’a été engagée par les pollueurs.
En plus de ces cas ayant donné lieu à dépôt de plainte, l’association a reçu nombre de signalements portant sur des écoulements d’eaux usées, parfois rapidement réparés par le responsable (la collectivité ou le délégataire type Veolia ou Saur).
Les stations d’épuration sont dimensionnées au milieu récepteur dans lequel elle rejette les eaux traitées. Ainsi, si le cours d’eau est un petit ruisseau, les conditions de rejet seront plus exigeantes qu’en pleine mer...bien que cela reste très discutable.
Dans le cas de Landaul, le fonds du fossé, milieu récepteur du point de rejet est totalement colmaté et des couleurs rougeâtres au fond ont également été observées. L’état de dégradation du milieu est tel que toute vie sensible au milieu ne peut survivre. Des amas de ponte d’amphibiens ont été observés en nombre d’une dizaine entre l’enceinte de la station dépuration et la zone de rejet. Il s’agit d’une observation de ponte de grenouille rousse ou agile (espèces protégées en France). Le site est un donc un habitat pour ces espèces protégées au titre de l’arrêté ministériel du 08 janvier 2021 et leur milieu également au titre de l’article L 411 – 1 du code de l’environnement. Dès lors, ce milieu abritant ces espèces ne peut être dégradé.
Un projet de construction de feeder (tuyau) d’alimentation en eau potable depuis le Blavet pour le territoire d’AQTA (interconnexion Baud-Brec’h) vient au secours des risques de pénuries en eau qui ont été durement vécus en 2022, et qui ont malheureusement la forte probabilité de se renouveler. Si l’approvisionnement en eau potable est une démarche louable, elle vient ici au secours du développement du pays d’Auray, mais cette eau potable se transformera inévitablement en eau usée... A-t-on prévu le nécessaire pour traiter ces prochains volumes ?
S’agissant du signalement de Bubry, les eaux polluées ont été rejetées dans le cours d’eau du Brandifrout qui fait l’objet d’une protection particulière : un arrêté préfectoral de protection de biotope pour la mulette perlière signé en 2021.
Le constat est sans appel : tout le réseau d’assainissement dysfonctionne dans les territoires littoraux (Auray Quiberon Terre Atlantique, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et Lorient Agglomération probablement dans une moindre mesure).
Ces territoires subissent une énorme pression pour l’ouverture à l’urbanisation.
Outre l’attention de que nous réservons à la bonne application du principe de zéro artificialisation nette (ZAN), la ressource en eau reste notre point d’attention de plus crucial.
Nos activités humaines dépendent de nos capacités d’assainissement et de notre ressource en eau. L’eau et les rivières, sont à la fois milieu approvisionnement en eau potable et milieu récepteur des eaux traitées (eaux usées après traitement). L’eau reste donc le facteur limitant aux développements des activités humaines.
Les pollutions dont nous faisons état ne sont pas simplement liées à la capacité de traitement de la station d’épuration. Elles sont liées aux réseaux d’eaux usées, aux postes de relevage des eaux usées, à la (non) séparation des eaux usées avec les eaux pluviales, aux gestions de leurs boues. C’est cet ensemble qui est dans un état catastrophique, sans parler des assainissements individuels et des vidanges qui doivent être réalisées dans les règles.
Les réseaux d’assainissement dysfonctionnent particulièrement par temps de pluie...il serait donc urgent de travailler sur la gestion des pluviales et de ralentir le cycle de l’eau.
En gros, il faut faire tout l’inverse en matière d’aménagement du territoire que ce qui a été fait jusqu’à présent, où il fallait évacuer l’eau le plus rapidement à la mer => en travaillant tant sur les surfaces urbanisées que sur les bassins versants. Ce sont nos sols qui sont nos plus puissants réservoirs d’eau.
Les politiques d’aménagement doivent donc être revues, et chacun doit prendre ses responsabilités. Qui doit faire quoi ?
– L’État doit s’assurer que les territoires proposent des perspectives d’aménagement supportables => nous demandons au Préfet du Morbihan de geler tous les permis de construire et toute ouverture à l’urbanisation dans les PLU et les Scot. Il est grand temps qu’il exerce à nouveau son contrôle de légalité comme cela avait été fait par le précédent préfet pour les communes de Carnac et Ploëmel.
– Les collectivités territoriales (Communautés de communes) ont la compétence GEMAPI (gestion de l’eau, des milieux aquatiques et de prévention des inondations). Elles doivent faire les travaux d’entretien et de vérification des branchements eaux usées.eaux pluviales nécessaires. Les projets d’aménagement, de construction de lotissement et tout autre permis de construire devraient suivre un cahier des charges (obligations et non recommandations) pour infiltrer l’eau à la parcelle (parking de ZAC, lotissement....aménagement routier), le ralentissement du cycle de l’eau passe aussi par une modification des pratiques agricoles (préservation des zones humides, prairies humides, dédrainage des parcelles, restauration du maillage bocager par la plantation de haies)
Pour AQTA, un Plan Marshall de l’eau avait été annoncé lors de la visite de madame la Ministre de la Transition Ecologique au cours de laquelle un accent avait d’ailleurs été mis sur la nécessité de reconstituer le bocage. Cette annonce avait été formulée dans le cadre de France Relance qui a soutenu les collectivités pour améliorer leurs assainissements.
– Les mairies doivent réviser leur PLU en étant responsable => quel développement urbain est-il possible si l’assainissement n’est pas conforme ? Les prévisions démographiques des PAGD doivent tenir compte de l’état des réseaux d’assainissement.
Nous insistons : « il est inacceptable de poursuivre l’urbanisation tant que nous ne parvenons à gérer notre m....décemment, c’est absolument honteux pour notre territoire »