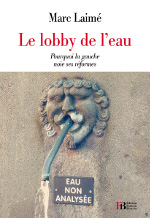Le Royaume-Uni comme les États-Unis viennent de présenter de nouveaux plans pour soutenir la mise en place d’infrastructures pour l’IA dans leurs territoires. Mais actuellement, aux États-Unis, de nouvelles centrales au gaz sont ouvertes pour répondre aux demandes d’énergie de l’IA. Au Royaume-Uni, l’implantation par le gouvernement de sa « première zone de croissance de l’IA » près d’un nouveau réservoir pose la question des priorités d’accès à l’eau.
(…)
Le gouvernement du Royaume-Uni vient d’annoncer une stratégie nationale pour faire de son pays un leader en matière d’intelligence artificielle. Il prévoit entre autres des « Zones de croissance de l’IA » (IA growth zones), « des zones bénéficiant d’un meilleur accès à l’électricité et d’un soutien pour les autorisations de planification, afin d’accélérer la mise en place d’une infrastructure d’IA sur le sol britannique », comme l’explique le communiqué du Secrétariat d’État à la science, à l’innovation et à la technologie.
Mais des questions se posent sur l’emplacement prévu de la première « zone de croissance ». Situé à Culham, au siège de l’Autorité britannique de l’énergie atomique (UKAEA), cet endroit est aussi celui du premier nouveau lac de barrage construit depuis 30 ans aux Royaume-Uni, « qui était censé fournir de l’eau aux habitants du sud-est de l’Angleterre, qui souffre d’un grave problème d’approvisionnement en eau », explique le Guardian.
Le journal britannique souligne que cette région est celle qui, selon l’agence environnementale nationale, est la plus sensible du pays aux manques d’eau. Entre les réserves d’eau disponibles et la demande attendue sans compter les data centers, le sud-est du pays sera confronté à un déficit potentiel de plus de 2,5 milliards de litres par jour d’ici 2050. »
https://next.ink/165467/lacceleration-de-lia-pose-deja-des-questions-de-penuries-deau-et-denergie/
Nous avons recueillis les échanges entre plusieurs acteurs et observateurs de la société civile autour de la gestion de l’eau potable et de l’assainissement et des services publics en général dans la région de Montpellier. A mille lieux de la propagande officielle, le choc du réel…
(…) Comment évoluent les modes de gestion de l’eau potable et de
l’assainissement collectif en France depuis 2008 ? Visualisation dynamique nationale et par département réalisée par
Akwari Coop, qui suit le pourcentage de la population desservie par
des régies publiques (courbe d’évolution à la fin de l’animation) :
https://akwari.org/evolution-de-la-gestion-de-leau-en-regie-publique-par-departement/
Entre 2008 et 2023, la part de la population totale desservie par une
régie publique est passé de 38% à plus de 47%, avec une accélération
récente avec le passage en gestion directe de collectivités telles que
la Métropole de Lyon (avec Eau du Grand Lyon) et de Bordeaux Métropole
(avec la Régie de l’Eau Bordeaux Métropole Métropole).
La production de ces cartes a été rendue possible par les données
ouvertes mises à disposition par l’Observatoire National des Services
Publics d’Eau et d’Assainissement – SISPEA. »
(…) Merci à Akwari Coop pour avoir effectué cette analyse intéressante mais
ô combien fastidieuse. J’aimerais cependant avoir des précisions sur la
méthodologie employée.
Selon la FNCCR, la SemOp est considérée comme un mode de gestion privée
et la SPL comme un mode de gestion publique. Qu’en est-il d’une SPL
intercommunale chapeautant à la fois des régies et des dsp communales,
comme par exemple, la SPL de Grenoble Alpes Métropole pour le service
eau potable (régie pour la commune de Grenoble, DSP pour les autres
communes) ? Est-ce que Akwari Coop a comptabilisé la population ou
niveau communal ou au niveau intercommunal ?
La population d’un service eau potable dont la production est opérée par
le privé et la distribution par le public est-elle comptabilisée comme
desservie par le public ou le privé ?
Même question pour les services eau potable ou assainissement dont la
régie ou la SPL sous-traite certaines de ses fonctions de base au privé
sous forme de marché public ou marché globale de performance, comme par
exemple, la régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole qui
sous-traite à Veolia et Saur l’exploitation des stations d’épuration,
des postes de relevage et du réseau de collecte des eaux usées.
Cette tendance à sous-traiter au privé des fonctions de base d’une régie
ou d’une SPL est très fréquente actuellement et n’est pas prête à
diminuer avec l’application du plan eau et la transcription dans la
législation française des directives européennes eau potable et eaux
usées urbaines. »
(…) A propos de la conférence intitulée : « faut-il construire des routes, le cas du COM » avec une seconde partie soporifique.
Hier soir à mardi 14 septembre déroulait à la faculté d’économie de Richter (Montpellier) une conférence intitulée : « faut-il construire des routes, le cas du COM ?
La première partie fut animée par deux universitaires dont on peut résumer leur (trop courte ?) intervention par : « le budget temps d’un individu consacré aux déplacements de tous les jours reste constant, autour d’une heure ; toute augmentation de la vitesse du déplacement se traduit par un allongement de sa portée. Concernant les déplacements « individuels » motorisés, toute augmentation de la capacité de la voirie se traduit par une induction de trafic exprimée en véhic ule.kilomètre »
⇨ C’est fondamental à s’approprier car à la base de toute argumentaire utilisé pour contrer le projets d’infrastructures routières quelle que soit leur taille
⇨ Il aurait été opportun que nos deux universitaires aient du temps supplémentaire pour conclure :
* d’une part sur la faillite d’un modèle économique basé sur l’accointance entre la branche économique du BTP et celle des industries mécaniques, plus particulièrement son secteur des véhicules motorisés sur pneumatiques (voitures, camions, tracteurs….) ; n’oublions pas que celle des industries mécaniques en Europe occidentale a doublement été percuté (perte d’emplois qualifiés faisant partie des facteurs explicatifs du transfert du vote de certaines formations politiques à d’autres), d’une part par le transfert en Europe de l’Est d’usines (Slovaquie, Roumanie, Pologne ...), d’autre part par l’exportation en augmentation accélérée de Wattures en provenance de la Chine, augmentation facilitée par les constructeurs allemands voulant continuer à exporter en chine alors même qu’ils ont perdu le leadership industriel, technologique ... sur tous les produits à base d’électrons !!! Oui, le COM pose également le problème économique de nos industries mécaniques externalisées en Chine !
⇨ d’autre part l’absence chez les politiciens d’une capacité visionnaire pour passer de ce modèle économique archaïque à un nouveau modèle basé sur la décarbonation de l’activité économique, dont les déplacements font partie !
⇨ N’oublions pas que Montpellier a bénéficié de 1977 à 2010 d’un « visionnaire », d’un de ces rares mais nécessaires politiciens capables de piloter la « transition » sur le temps long d’un territoire en forte évolution, ici d’autant plus que le moteur démographique est plutôt celui d’une Ferrari que celui d’une Twingo
⇨ Un « visionnaire » aurait compris la nécessité de refroidir le moteur démographique et de transférer son surplus d’énergie sur des territoires en manque. Georges Frêche l’avait compris mais Dieu l’a rappelé à lui sans qu’il n’ait eu le temps (ou la volonté) de former des successeurs en capacité de poursuivre le pilotage de la transition. Ses successeurs se contentent de remettre régulièrement une pièce dans la machine
⇨ La seconde partie consacrée au COM fut soporifique, loin d’être à la hauteur de la premi 32 ;re partie
Était-ce bien utile de « longuement » répéter un plaidoyer sur l’inutilité d’un contournement routier ?
⇨ N’aurait il pas fallu, bien au contraire, focaliser sur des décideurs politiques qui préfèrent la facilité intellectuelle à répéter « fluidité, fluidité, fluidité » à l’effort intellectuel nécessaire pour affronter la faillite avérée d’un aménagement, plutôt d’un bouleversement du territoire, nous conduisant en particulier au dérèglement climatique et à la forte dégradation de la qualité de vie de l’humain sur nos territoires ?
⇨ Le rôle du Duo associatif aurait dû être d’ouvrir des perspectives à partir des enjeux identifiés comme le besoin du BTP de continuer à consommer du foncier malgré les évidences ? Le re présentant des Shifthers a fait court et convaincant sur la fausse décarbonation induite par la fluidification supposée du trafic
⇨ Heureusement que certains activistes ont déposé des recours judicieusement conçus pour contraindre voire stopper un projet inutile d’autant plus qu’un des deux universitaires présents à indiqué que seul le péage d’une infrastructure routière permettait le maintien de sa fluidité en faisant varier le prix en fonction de l’intensité prévisionnelle de la circulation ; cela s’appliquerait excellemment à l’établissement d’un cordon ombilical à péage et sans échangeur intermédiaire entre l’A750 (Juvignac) et l’A9 (celle à péage) avec la mise en oeuvre préalable d’un réseau ferroviaire performant ancré / accroché au réseau de tramway de Montpellier ; encore faudrait-il que la Métropole devienne visionnaire plutôt que gestionnaire du pseudo transport gratuit."
(…)
Tu évoques ce qu’on peut appeler la "relégation territoriale" qui est le terreau de l’extrême-droite qui nous menace.
• villages-dortoirs périphériques et vieux villages ruraux insalubres, d’un côté, avec un gradient de pauvreté/chômage et d’absence de services publics croissant avec la distance,
• métropoles-centre gentrifiées concentrant les services publics et marchands, de l’autre,
• et avec des réseaux routiers sur-densifiés/sur-équipés entre les deux au détriment des transports publics délaissés et découpés en "fiefs territoriaux" souvent déconnectés ce qui n’aide guère à la mobilité, tant ferroviaires (TER, Inter-Cités...) que routiers individuels (Blablacar...) ou collectifs privés ou publics (FlixBus/bus Macron, Lio et TAM à trop faible inter-connexion...).
C’est le propre des "métropoles barbares" qui sont la résultante de plusieurs facteurs combinés agissant dans l’inconscient politique tant de ses victimes que de ses décideurs :
• la mise à mort voulue de l’ingénierie publique d’intérêt général, locale (FPT) et nationale (grands corps d’ingénieurs), compétente et responsable, aujourd’hui désarmée, numérisée et délocalisée, occasionnant pertes de mémoire et pertes de savoir-faire du secteur public, véritable trou d’air appelant les grands groupes privés à la rescousse ou la "start-up-isation" des hauts fonctionnaires, devenant des électrons libres "business angels" sans contrôle du politique ;
• la concentration des fonds publics nationaux dans "l’aide aux entreprises", 1er budget national, sous prétexte de compétitivité (et non de coopération) pour réaliser à moindre coût, ce qui s’avère faux car plus coûteux ex-post, https://www.blast-info.fr/articles/2024/60-milliards-de-dette-pour-les-francais-la-grande-arnaque-continue-avec-bayrou-vgS530cWRNy34ZWwMOySjw
• la caporalisation de l’enseignement et de la recherche publics, et sa privatisation élitaire en véritable fracture sociale,
• l’hégémonie durable des baronnies clientélistes et autoritaires issues de la double-décentralisation Deferre et Acte III qui affecte aussi bien la gauche que la droite ;
• la commande publique dérégulée, car marchandisée au travers des passations de marchés publics hyper-concurrentielles, à la fois paradoxales et sans limites (paradoxal passage des seuils de marchés publics en gré-à-gré de 3000€ à 100000€ sans concurrence (entre autres pour les AMO) pour des gros marchés d’études/travaux/services ouverts à la concurrence internationale, bien que celle-ci contrariée par des effets d’oligopole (les fournisseurs d’une métropole sont historiquement les mêmes -en façade- mais sont absorbés par des groupes à dimension internationale, yc en paradis fiscal ou en pays dominants type USA, en simple captation de rentes... ah si qqn pouvait travailler sur les bureaux d’études, ce serait instructif) (cf. Directive européenne LPS)
Il y a certainement d’autres dimensions concomitantes.
Mais je crois qu’il faut regarder les réalités en face qui sont, en traduction locale, celles de la mutation du capitalisme aujourd’hui bien plus financier qu’industriel.
Penser global, agir local certes, mais aussi penser local pour l’agir global. Sans cette dialectique, il n’y a que "pleurnicheries des vaincus" comme disait l’autre. »
Les annonces de baignades l’été prochain qui se multiplient à l’initiative de collectivités en IDF sont à la fois la réalisation des « promesses » de l’héritage annoncé des JO, et une récupération opportuniste d’un prétendu succès médiatique planétaire, dont les édiles qui les promeuvent escomptent récupérer quelques miettes à l’approche des municipales.
Nonobstant aucune de ces baignades ne respectera les normes de la Directive européenne baignades, qui fixe notamment les taux d’E.coli et de coliformes fécaux à ne pas dépasser.
En IDF le premier niveau de recueil des eaux usées est assuré au niveau communal (désormais intercos ou syndicats), par des DSP de Suez et Veolia, qui ne sont pas concernées par la Directive baignades.
Ensuite ces flux rejoignent le tentaculaire réseau du SIAAP qui les traite dans ses 6 usines décentralisées, implantées au delà de la « zone centrale », soit Paris intra muros et une partie de la petite couronne.
Ledit SIAAP, qui dessert 9 millions de Franciliens en petite et en grade couronne, vient tout juste d’annoncer que les travaux de réfection de son usine d’élévation historique de Clichy (1890) allaient débuter, un marché de 341 millions d’euros qui avait fait l’objet d’un scandale autour de suspicion de marchés truqués il y a quelques années (Elise Lucet, Envoyé spécial).
Or cette usine d’élévation, comme son nom l’indique, a pour vocation de recueillir les EU non traitées de Paris et de la "zone centrale" (une partie de la petite couronne), pour les acheminer vers l’une ou l’autre des 6 usines décentralisées du SIAAP situées hors zone centrale.
Autrement dit la zone où se déroulaient les fameuses baignades des JO… baignait dans un mélange d’EU et d’EP non traitées, ce que nous avons eu de cesse de dénoncer.
Concernant les annonces démagogiques de baignades en IDF l’été prochain, il conviendrait donc d’établir une cartographie précise du traitement des EP et des EU sur le territoire concerné.
Elle établira sans coup férir que le traitement lacunaire (ou l’absence) de traitement desdits effluents témoigne d’une violation flagrante des obligations imposées par la Directive baignades.
La solution ? Déclarer pour s’y soustraire qu’il s’agit d’une baignade « expérimentale », comme l’avait fait la Mairie de Paris, couverte dans cette entourloupe par le Préfet de la Région IDF.
Nous maintenons donc qu’il s’agit donc là d’une escroquerie sans précédent, comme l’ont aussi établi, s’agissant des baignades des JO, les enquêtes de la cellule investigation de Radio France.
Pour aller plus loin voir l’arrêté SOCLE–IdF (2016) ;
La thèse d’Emma Thébaut sur le traitement des EP (2018) ;
L’annonce du lancement des travaux de l’usine d’élévation de Clichy (janvier 2025).
Lire aussi : l’héritage calamiteux des JO au village des athlètes à Dugny...
Le site web du Cerema dédié à la gestion des eaux pluviales urbaines :
Plein d’infos techniques et réglementaires sur un sujet que personne ne
maîtrise vraiment...
L’éphémère gouvernement Barnier qui comptait au rang de ses secrétaires d’état notre infernale Mame Gatel qui œuvre depuis dix ans au Sénat à supprimer cette loi honnie avait proclamé l’urgence sur la proposition de loi qui prévoyait la fin du transfert obligatoire de l’eau et de l’assainissement aux CC avant le 1er janvier 2026. Lou Bayrou, submergé par ses Himalayas va-il l’imiter ?
Le 9 octobre 2024, au Sénat, le Premier Ministre d’alors annonçait la fin du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes en 2026 :
Source Sénat : https://videos.senat.fr/video.4759779_6706741196c1d.seance-publique-du-9-octobre-2024-apres-midi
Ledit Sénat, dès le 17 octobre 2024, votait la proposition de loi n° 7 « visant à assouplir la gestion des compétences ” eau ” et ” assainissement ”
(procédure accélérée) » :
https://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2023-2024/556.html
L’urgence avait donc été déclarée sur ce texte, conduisant à une seule navette.
Le texte devait passer en plénière à l’A.N. le 17 ou le 18 décembre 2024, mais patatras, exit Barnier….
Les deux dates où ce texte devait passer en commission des lois ont donné lieu à l’examen de textes plus urgents.
Le Sénat étant quasi unanime, l’Assemblée Nationale semblait pouvoir suivre.
Avec Lou Bayrou rendez-vous le 1er avril ?
Une étude à consulter pour qui s’intéresse au sujet.
L’ARRA² publie les résultats de l’étude lancée en 2022, visant à dresser un état des lieux détaillé des métiers de la gestion de l’eau. L’étude analyse les missions, les compétences, les rémunérations des professionnels, ainsi que leurs perceptions de l’impact de la compétence GEMAPI sur leurs activités et leurs structures. Ce travail s’inscrit dans la continuité des études menées depuis 2003, dans le cadre d’une démarche globale de structuration du secteur, tant à l’échelle régionale en Auvergne-Rhône-Alpes qu’à l’échelle nationale, en partenariat avec les autres réseaux professionnels et leurs adhérents.
Source : Association Rivière Rhône Alpes Auvergne
Au motif de simplifier le droit de la commande publique, deux décrets passés subrepticement ouvrent la voie à la multiplication des délits lors de la passation de marchés par des collectivités ou des services de l’état.
A la lecture de cet article, vous comprendrez mieux comment métropolisation/urbanisation/artificialisation prospèrent à l’aval d’une commande publique dérégulée... (bureaux d’études filialisés et consultants freelance fourmillant au service de projets démultipliés et de plus en plus rapides et massifs car numérisés), n’autorisant guère de recours faute de délais suffisants et de services publics outillés pour un contrôle de légalité préfectoral bien délaissé... (en quelques années, passant par exemple de 8 à 2 agents en Hérault pour 1 million d’habitants) ce qui affecte fortement les territoires communaux.
« En matière de droit de la commande publique, il est assez habituel de finir l’année avec un ou deux nouveaux textes venant apporter quelques nouveautés. Le contexte politique actuel laissait présager une fin d’année sans cadeau pour les amateurs de droit de la commande publique mais finalement, un dernier cadeau est apparu au sein du Journal Officiel du dernier jour de l’année sous la forme du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique.
Ce décret qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025 comprend, d’après la Direction des affaires juridiques de Bercy "les principales mesures en matière de commande publique proposées par les opérateurs économiques comme par les acheteurs dans le cadre des Rencontres de la simplification initiées à l’automne 2023" et "tire également plus largement les conséquences des attentes exprimées par les opérateurs économiques concernant tant la simplification de l’accès à la commande publique, notamment la phase de candidature aux marchés publics, que l’assouplissement de leurs règles d’exécution financière afin d’alléger les tensions pesant sur la trésorerie des entreprises".
Faisons ensemble un petit tour d’horizon des principales mesures contenues au sein de ce décret.
Premièrement, ce décret vise à faciliter l’accès des Petites et Moyennes Entreprises (ci-après PME) et artisans à la commande publique en assouplissant certaines règles. Ainsi, le montant maximum de la retenue de garantie est réduit de 5 % à 3 % pour les marchés publics de certains acheteurs (l’Etat, les établissements publics administratifs de l’Etat, autres que les établissements publics de santé, dont les charges de fonctionnement annuelles sont supérieures à 60 millions d’euros ainsi que les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses de fonctionnement annuelles sont supérieures à 60 millions d’euros) dont le titulaire est une PME. Egalement, la part minimale confiée que le titulaire d’un marché global, d’un marché de partenariat ou d’un contrat de concession doit confier à des PME ou artisans est relevé à 20 %.
Deuxièmement, en matière financière, le décret supprime le seuil de 80 % du montant HT du marché à compter duquel l’avance versée devait avoir été remboursée.
Ensuite, troisièmement, le seuil de dispense de publicité et mise en concurrence préalables pour les marchés innovants de défense ou de sécurité est relevé à 300 000 euros HT. Ces dispositions sont également applicables aux "petits" lots, c’est-à-dire aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services innovants ou à 100 000 euros hors taxes pour des travaux innovants.
Quatrièmement, le décret prévoit également que la composition d’un groupement d’opérateurs économiques peut être modifiée dans le cadre de procédures de passation incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, ce qui vient atténuer le principe d’intangibilité des groupements.
Cinquièmement, le texte précise ensuite, de manière explicite, qu’il est possible de conclure un accord-cadre comportant une partie à bons de commande et une partie avec des marchés subséquents à condition que cela ait été annoncé au sein des documents de la consultation.
Enfin, sixièmement, le décret intègre les mesures règlementaires d’application de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte en prévoyant que les entités adjudicatrices peuvent désormais rejeter une offre contenant des produits provenant de certains pays tiers à l’Union européenne, sous certaines conditions.
(…)
Depuis quelques années, si le montant de leurs besoins en matière de travaux est inférieur à 100 000 euros HT, les acheteurs publics peuvent conclure un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables.
Ce seuil qui devait expirer au 31 décembre 2024 a été prolongé, jusqu’au 31 décembre 2025, par le décret n°2024-1217 du 28 décembre 2024 relatif au seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux.
Cette prolongation qui a tardé à arriver devrait satisfaire de nombreux acheteurs !
Reste désormais à savoir si cette mesure sera enfin pérennisée, probablement dans le cadre du futur décret de simplification du Code de la commande publique annoncé depuis quelques temps mais qui tarde à venir... »
Source : Blog Landot.
Au regard des l’actualité nous republions une conférence que nous avions prononcée en 2016...
Comment la création d’Israël a-t-elle perturbé l’organisation de la gestion de l’eau en Palestine ?
Dans quelle mesure la ressource en eau est-elle un enjeu stratégique dans la dynamique de colonisation d’Israël ?
Comment et par qui la gestion de l’eau est-elle réglementée à Gaza ?
Le comité Palestine Paris 1 Panthéon Sorbonne organise le mardi 17 décembre 2024 de 18h à 20h au Centre des Cordeliers (15 rue de l’École-de-médecine, métro Odéon, une conférence-débat dédiée à un sujet crucial : l’eau en Palestine.
Elle sera animée par Mme Julie Trottier, hydrologue, chercheuse au CNRS et experte de la gestion de l’eau en Palestine.
Programme :
18h-18h40 : Histoire de la gestion de l’eau en Palestine ;
18h40-19h : Focus sur la situation actuelle à Gaza et en Cisjordanie ;
19h-20h : Échange avec Mme Julie Trottier.
Lien d’inscription : https://forms.gle/uvunpuGHC4fTCB387
La ressource en eau diminue sous l’effet du changement climatique. Parallèlement, notre système agricole représente plus de la moitié de l’eau consommée annuellement en France.
Pour mieux comprendre comment cette consommation d’eau se répartit, comment elle devrait évoluer dans les années à venir et les marges de manoeuvre disponibles, la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB) et Terre de Liens vous proposent un nouveau webinaire le lundi 16 décembre 2024 de 12h à 13h30.
Hélène Arambourou, de France Strategie, présentera les résultats de l’étude Prélèvements et consommations d’eau : quels enjeux et quels usages ? qui revient en détail sur les sur les usages actuels de l’eau et évalue ses évolutions futures à horizon 205
En faisant dialoguer plusieurs approches, cette journée d’étude vise à faire vivre ce nécessaire débat pour permettre de décrire la modification des rapports des sociétés humaines à l’eau au XIXe siècle.
« La disponibilité, les usages et les contaminations des eaux seront des sujets centraux des prochaines décennies. Les hydrologues estiment qu’un bouleversement global du cycle de l’eau douce est en marche (Oki et Kanae 2006). Ce bouleversement est la conséquence à la fois du dérèglement climatique d’origine anthropique et de l’utilisation toujours plus importante de l’eau douce pour les activités humaines (Savelli et al. 2023). À l’issue de la « Conférence des Nations Unies sur l’eau », qui s’est tenue en mars 2023 à New York, première rencontre de ce type organisée depuis 1977, un rapport est publié sur les ressources globales en eau (Connord et Miletto 2023). Il estime que « l’utilisation des ressources en eau dans le monde augmente de près de 1 % par an et devrait continuer d’augmenter à un rythme similaire jusqu’en 2050 ». Il affirme également qu’aujourd’hui « 46 % de la population mondiale (3,6 milliards de personnes) n’a pas accès à des services d’assainissement gérés de façon sûre ».
La situation climatique et la modification des activités humaines ont asséché de très nombreux territoires, et de vastes régions du monde connaissent une désertification rapide.
Les tensions hydriques que subissent d’un côté les écosystèmes, et de l’autre les infrastructures humaines de collecte et de distribution, sont à l’origine d’une multiplication de conflits d’usages de l’eau. Ces conflits alimentent des débats de sociétés qui remettent en cause les modèles de développement choisis ou imposés, au point que la disponibilité et la gestion de l’eau sont devenues « l’un des principaux domaines de contestation des politiques néolibérales » (Le Gouill, Cortinas Muñoz, et Poupeau 2019).
Ces dernières décennies, alors que nos sociétés réalisaient l’importance des contaminations et pollutions imposées aux environnements par deux siècles d’intense activité industrielle, l’historiographie a su produire une histoire sociale des pollutions et de leur acceptabilité. Cette histoire a interrogé la diversité des pratiques déployées par les acteurs économiques, les institutions scientifiques, et les administrations publiques pour faire tolérer les rejets polluants, toxiques ou insalubres dans les environnements. Ainsi, la contamination précoce, au XIXe siècle, des rivières d’Europe occidentale par les activités industrielles a été particulièrement bien décrite (Carré et Lestel 2021 ; Massard-Guilbaud 2010 ; Francois Jarrige et Le Roux 2020 ; Le Roux 2011).
Aujourd’hui, alors que les conflits d’usage de l’eau en tant que ressource se multiplient, la discipline historique doit effectuer un travail similaire à celui réalisé pour les pollutions industrielles afin de produire une histoire de la mise à disposition de l’eau pour les activités humaines. À ce titre, le XIXe siècle s’avère être une période charnière. Nos sociétés contemporaines héritent des mutations des rapports à l’eau qui naissent durant ce siècle, notamment dans les pays occidentaux en voie d’industrialisation et dans les espaces coloniaux.
En faisant dialoguer plusieurs approches, cette journée d’étude vise à faire vivre ce nécessaire débat pour permettre de décrire la modification des rapports des sociétés humaines à l’eau au XIXe siècle. En particulier, on entend s’intéresser aux nouvelles stratégies de l’accaparement de l’eau qui voient le jour au profit d’intérêts économiques émergents durant ce siècle. Cette journée, et le dossier qui la suivra, proposent donc tout d’abord de considérer l’eau comme une ressource minérale qui, au même titre que le charbon, le bois, ou divers métaux, a été centrale dans le développement industriel (Axe 1). En partant de cette affirmation, on propose de mettre en avant les nouvelles matérialités de l’accaparement et de réfléchir à l’évolution de la place des États modernes dans l’évolution des rapports à l’eau des sociétés au XIXe siècle (Axe 2). Enfin, en travaillant sur l’évolution du fait urbain, on entend mettre l’accent sur les conflits que fait surgir l’accaparement de l’eau durant la période (Axe 3).
Premier axe : L’eau, une ressource minérale au service de l’industrialisation ?
Le XIXe siècle peut être décrit comme une période de transition d’une « économie organique » à une « économie minérale » (Charbonnier 2020). Cette économie minérale est caractérisée par l’extraction d’immenses quantités de ressources fossiles pour produire de l’énergie. La mutation des systèmes énergétiques au XIXe siècle a pourtant été tributaire de la mise au travail de vastes quantités d’eau. Si les machines à vapeur ne pouvaient fonctionner sans eau, l’historiographie de la période a également montré l’importance des roues hydrauliques dans le mix énergétique des sociétés en voie d’industrialisation au XIXe siècle (Malm 2016 ; Benoit 2020 ; Steinberg 1994 ; Fressoz 2024).
De même, les procédés industriels, en se diversifiant, inventent de nouveaux usages de l’eau (chimie, refroidissement des machines…) tandis que des usages ancestraux de l’eau sont également perfectionnés et requièrent une ressource toujours plus abondante et domestiquée, que ce soit pour le transport par flottage (Jacob-Rousseau, Jarrige, et Langoureau 2023), le lavage des laines ou des cotons (Gagnepain 2023), le rouissage (François Jarrige 2019), ou les teintures, entre autres.
Tous ces usages invitent à considérer l’eau comme une ressource minérale centrale dont la disponibilité fut, au même titre que celle du charbon ou du bois, indispensable au développement des sociétés industrielles. Étudier les usages de l’eau au XIXe siècle oblige donc à s’intéresser à l’évolution des techniques ayant permis la mise à disposition de cette ressource. La période voit ainsi le perfectionnement des techniques de forages, le développement de nouveaux savoirs hydrographiques (Parrinello 2017) susceptibles de domestiquer les rivières, de les canaliser et de rationaliser leurs débits, ainsi que l’invention de nouvelles pratiques de purification de l’eau.
Deuxième axe : Place de l’État, infrastructures et droit
Depuis ses travaux discutés sur les empires orientaux (Manning 2002), Karl Wittfogel a initié une tradition d’étude des structures étatiques au prisme de leurs rapport à l’eau (Wittfogel 1977). À ce titre, le XIXe siècle offre de nombreuses pistes de réflexion. Les nouveaux besoins en eau reconfigurent le rôle des États dans la mise à disposition de l’eau. Pourtant les droits de l’eau évoluent lentement (Ingold 2017 ; 2011).
En Europe occidentale, ce sont les pouvoirs administratifs qui prennent en charge la planification de multiples infrastructures de captage et de distribution de l’eau – canaux, barrages, canalisations, forages. La réalisation de ces travaux a pu tout autant reposer sur la collectivité qu’être confiée à des entreprises et des capitaux privés, notamment par le biais de concessions, qui forment un cadre juridique ménageant l’exploitation de la ressource en eau.
Ces cadres juridiques comme techniques de la mise en œuvre des infrastructures hydrauliques s’inscrivent par ailleurs dans des circulations transnationales d’expertise et de modèles (Tarr et Dupuy 1988). Il convient toutefois d’explorer les spécificités qu’ont pris les formes administratives et politiques qui ont facilité l’accaparement de l’eau, d’un côté dans les métropoles européennes en voie d’industrialisation, et de l’autre dans les territoires coloniaux.
Plusieurs travaux ont ainsi montré que les aménagements menés par les Britanniques sur le Nil à la fin du XIXe siècle s’insèrent dans une économie politique coloniale (Tvedt 2004 ; Derr 2019). Comprendre ce qui a rendu possible l’accaparement de l’eau nécessite donc une description fine des différents acteurs sociaux, économiques et politiques, qui participent à la construction d’un rapport « moderne » (Jarrige et Fureix 2020) à l’eau des sociétés au XIXe siècle.
Troisième axe : Urbanisation et conflits
L’approvisionnement des villes en eau au XIXe siècle se heurte à un défi : celui de la croissance des métabolismes urbains. La ville consomme et concentre de plus en plus de ressources, et produit de plus en plus de déchets (Wolman 1965 ; Barles 2002 ; Jarrige et Le Roux 2020).
L’intensification de l’accaparement de la ressource en eau au XIXe siècle s’effectue donc dans un contexte d’importantes mutations sociales et démographiques, qui se traduisent par une forte urbanisation, notamment dans les sociétés occidentales. La transformation des environnements urbains se fait sous l’action de différents acteurs – ingénieurs, médecins, urbanistes – motivés pour certains par des standards hygiénistes qui placent l’eau au cœur de la ville (Barles 1999). L’assainissement des villes s’accompagne d’une recomposition des ségrégations urbaines marquées par une inégalité d’accès à la ressource.
L’histoire de l’eau urbaine et de ses liens avec l’hygiénisme a été abondamment documentée (Frioux 2013), aussi il convient de s’intéresser à d’autres facteurs moteurs de la mise à disposition de l’eau en ville : l’introduction de capitaux, le déploiement d’une expertise technique, la volonté politique (Hamlin 2009).
Pour s’approvisionner en eau au XIXe siècle en quantité suffisante, les métabolismes urbains organisent leur domination des bassins versants adjacents pour assurer leurs besoins de consommation, s’apparentant dans un certain cas à ce que Sabine Barles désigne comme un impérialisme hydraulique. Le domaine de la ville s’étend donc désormais au-delà des frontières urbaines. L’exemple de Paris a permis d’explorer l’interdépendance entre la ville et son fleuve (Backouche 2016), voire même « l’extraterritorialité » de la ville sur le bassin de la Seine (Barles 2012). Cela se traduit par une domestication des rivières par leur endiguement par exemple, et par la construction de canaux qui détournent et acheminent l’eau jusqu’à la ville – voir par exemple : (Graber 2009 ; Soll 2013 ; Morgan 2015 ; Haidvogl et al. 2018). Cette intensification de l’utilisation de l’eau par les villes a de nombreuses conséquences environnementales, en particulier l’assèchement des nappes phréatiques, ce qui pose la question de la désertification de certains espaces au profit de l’approvisionnement d’autres. Les infrastructures permettant la conduite d’eau jusqu’à la ville peuvent en effet entrer en conflit avec d’autres usages de l’eau, notamment ses usages agricoles ou de navigation commerciale.
Ces trois axes nous semblent susceptibles la fois de permettre de mieux comprendre les mécanismes d’accaparement de l’eau au XIXe siècle, mais aussi de traiter les différentes problématiques que cet accaparement a fait surgir, au carrefour des enjeux urbains, industriels, démographiques et impériaux. Nous proposons de relire le XIXe siècle au prisme de l’eau, au cours de cette journée qui sera suivi de la publication d’un dossier de 4 à 6 articles. »
Date : 11 Juin 2025.
Lieu : École Normale supérieure, Paris.
Salle : Salle du CERES (E045), 24 rue Lhomond 75005 PARIS
Organisateur.trice.s : Gagnepain Yaël (IHMC, CERES ENS-PSL), Pasquier Émilie (CHSP Sciences Po).
Bibliographie
Backouche, Isabelle. La trace du fleuve : La Seine et Paris, 1750-1850. Paris : Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2016, 430 p.
Barles, Sabine.
La ville délétère : médecins et ingénieurs dans l’espace urbain, XVIIIe-XIXe siècle. Seyssel : Champ Vallon Éditions, 1999, 384 p.
« Le métabolisme urbain et la question écologique ». Les Annales de la Recherche Urbaine, 92 (1), 2002, 143-50.
« The Seine and Parisian Metabolism : Growth of Capital Dependencies in the Nineteenth and Twentieth Centuries ». In Castonguay, Stéphane et Evenden, Matthew, Urban Rivers. Remaking Rivers, Cities, and Space in Europe and North America. Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, 2012, p. 94-112.
Benoit, Serge. D’eau et de feu : forges et énergie hydraulique. XVIIIe-XXe siècles.
Une histoire singulière de l’industrialisation française. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2020, 452 p.
Carré, Catherine, et Laurence Lestel (ed). Les rivières urbaines et leur pollution. Indisciplines. Versailles : Éditions Quæ, 2017, 282 p.
Charbonnier, Pierre. Abondance et liberté. Une histoire environnementale des idées politiques. Paris : La Découverte, 2020, 464 p.
Connord, Richard, et Michela Miletto. « Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau 2023 », 2023. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000384657_fre.
Derr, Jennifer L. The Lived Nile : Environment, Disease, and Material Colonial Economy in Egypt. Stanford : Stanford University Press, 2019, 264 p.
Fressoz, Jean-Baptiste. Sans transition. Une nouvelle histoire de l’énergie. Paris : Éditions du Seuil, 2024, 416 p.
Frioux, Stéphane. Les batailles de l’hygiène. Villes et environnement de Pasteur aux Trente Glorieuses. Paris : Presses Universitaires de France, 2013, 392 p.
Gagnepain, Yaël. « Entre accaparement et contamination : l’appropriation industrielle de l’hydrographie à Roubaix. Début du XIXe siècle - Milieu du XXe siècle ». Thèse de doctorat, Université de Lille, 2023, 622 p.
Graber, Frédéric. Paris a besoin d’eau. Paris : CNRS Éditions, 2009, 417 p.
Haidvogl, Gertrud, Winiwarter, Verena, Dressel, Gert, Gierlinger, Sylvia, Hauer, Fridriech, Hohensinner, Severin, Pollack, Gudrun, Spitzbart-Glasl Christina, et Raith, Erich. « Urban Waters and the Development of Vienna between 1683 and 1910 ». Environmental History, 23 (4), 2008, p. 721-47.
Hamlin, Christopher. « “Cholera Forcing” The Myth of the Good Epidemic and the Coming of Good Water ». American Journal of Public Health, 99 (11), 2009, p. 1946-54.
Ingold, Alice.
« Gouverner les eaux courantes en France au XIXe siècle : administration, droits et savoirs ». Annales. Histoire, Sciences Sociales, 66e année (1), 2011, p. 69-104.
« Terres et eaux entre coutume, police et droit au XIXe siècle. Solidarisme écologique ou solidarités matérielles ? », Tracés. Revue de Sciences humaines, n° 33 (septembre), 2017, p. 97-126.
Jacob-Rousseau, Nicolas, Jarrige, Nicolas, et Langoureau, Dimitri. Le flottage du bois en Europe. Techniques, sociétés et environnements. Dijon : Presses Universitaires de Dijon, 2023, 290 p.
Jarrige, François.
« Quand les eaux de rouissage débordaient dans la cité. Essai sur le mode d’existence d’une nuisance en France (XVIIIe-XIXe siècle) ». In Letté Michel, Le Roux, Thomas (dir.), Débordements industriels : Environnement, territoire et conflit (XVIIIe-XXIe siècle). Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2019, p. 137-53.
avec Fureix, Emmanuel. La modernité désenchantée. Relire l’histoire du XIXe siècle français. Paris : La Découverte, 2020.
avec Le Roux, Thomas. « L’invention du gaspillage : métabolisme, déchets et histoire ». Écologie & politique, 60 (1), 2020, p. 31-45.
avec Le Roux, Thomas. La contamination du monde. Une histoire des pollutions à l’âge industriel. Paris : Éditions du Seuil, 2017, 480 p.
Le Gouill, Claude, Muñoz, Joan Cortinas, et Poupeau, Franck. « Coupures d’eau et crise politique. Éléments pour une sociologie des transformations de l’État en Bolivie ». Politix, 127 (3), 2019, p. 135-59.
Le Roux, Thomas. Le laboratoire des pollutions industrielles. Paris, 1770-1830. Paris : Albin Michel, 2011, 560 p.
Malm, Andreas. 2016. « Who Lit This Fire ? Approaching the History of the Fossil Economy ». Critical Historical Studies, 3 (2), p. 215-48.
Manning, Joseph. « Irrigation et État en Égypte antique ». Annales. Histoire, Sciences Sociales, 57 (3), 2002, p. 611-23.
Massard-Guilbaud, Geneviève. Histoire de la pollution industrielle. France, 1789-1914. Paris : Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2010, 403 p.
Morgan, Ruth A. Running Out ? Water in Western Australia. Crawley : UWA Publishing, 2015, 320 p.
Oki, Taikan, et Kanae, Shinjiro. « Global Hydrological Cycles and World Water Resources ». Science, 313 (5790), 2006, p. 1068-72.
Parrinello, Giacomo. « Charting the Flow : Water Science and State Hydrography in the Po Watershed, 1872-1917 ». Environment and History, 23 (1), 2017, p. 65-96.
Savelli, Elisa, Mazzoleni, Maurizio, Di Baldassarre, Giuliano, Cloke, Hannah, et Rusca, Maria. « Urban Water Crises Driven by Elites’ Unsustainable Consumption ». Nature Sustainability, 2023, p. 1-12.
Soll, David. Empire of Water : An Environmental and Political History of the New York City Water Supply. Ithaca : Cornell University Press, 2013, 300 p.
Steinberg, Theodore. Nature Incorporated : Industrialization and the Waters of New England. Cambridge : Cambridge University Press, 1991, 302 p.
Tarr, Joel A., et Dupuy, Gabriel. Technology and the Rise of the Networked City in Europe and America. Philadelphia : Temple Univ Press, 1988, 339 p.
Tvedt, Terje. The River Nile in the Age of the British : Political Ecology and the Quest for Economic Power. Bloomsbury : Bloomsbury Academic, 2004, 464 p.
Wittfogel, Karl August. Le despotisme oriental : étude comparative du pouvoir total. Traduit par Micheline Pouteau. Paris : Éditions de Minuit, 1964, 672 p.
Wolman, Abel. « The Metabolism of Cities ». Scientific American, 213 (3), 1965, p. 178-90.